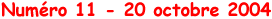Alternatives Citoyennes : On pourrait presque dire que vous êtes l'économiste attitré du syndicat. Vous en
animez les débats et les séances de formation, vous en préparez les rapports économiques majeurs. À ce titre, vous
avez sans doute de nombreux éléments d'information qui devraient vous permettre de prévoir des crises sociales et
des mouvements sociaux à venir. Ainsi, pensez-vous que dans les mois prochains l'UGTT aura à gérer ce véritable
drame social que sera la mise au chômage de 200 000 ouvriers du textile après la fermeture de quelques 2000
entreprises - vous corrigerez ces chiffres -, cela dans la suite du démantèlement des accords multifibres ? Le taux
de chômage de 15% environ va bondir, n'est-ce pas ?
Hassine Dimassi : Permettez-moi d'abord de vous préciser mes relations avec l'UGTT. Pendant une
certaine période (milieu des années 70-milieu des années 80), j'ai milité au sein de cette centrale syndicale non
seulement en tant que cadre de base (membre du comité du syndicat de l'enseignement supérieur) mais aussi et
surtout en tant que consultant lors des négociations salariales nationales. Depuis quelques années, j'ai décidé de
reprendre mon activité au sein de cette centrale, mais en m'y fixant une nouvelle mission : sensibiliser les
militants syndicalistes aux multiples et graves dangers qui menacent les travailleurs, tous les travailleurs. Je
tente d'assumer cette mission beaucoup plus en tant que militant qu'en tant qu'« économiste attitré ». Car cette
mission s'est avérée peu aisée.
D'abord, parce qu'il n'est pas facile du tout de vulgariser les terribles et complexes problèmes et défis de notre
temps. Ensuite, parce que les débats ne sont pas toujours fructueux et concluants. En fait, la majorité des cadres
syndicaux vivent aujourd'hui une étouffante contradiction. D'un côté, durant les deux dernières décennies, l'UGTT,
comme la majorité des centrales syndicales du monde, est demeurée quasi-passive face aux effrayantes mutations en
cours : totale ouverture de l'économie aux prédateurs étrangers, privatisation tout azimuts des entreprises
publiques, légalisation et diffusion sur une large échelle des emplois précaires, cloisonnement étanche des
frontières face aux émigrants aux abois... D'un autre coté, ces cadres syndicaux semblent faire fi de ces
mutations, en s'attachant fermement aux soi-disant « intérêts acquis » des travailleurs, du moins au niveau du
discours. En réalité, dans leur subconscient, la plupart des syndicalistes sont devenus préoccupés beaucoup plus
par la préservation de leur emploi et/ou de leur « poste syndical » que par la préservation des « intérêts acquis »
des travailleurs. Ce comportement dévastateur a amolli sensiblement le combat syndical et a cantonné l'UGTT dans
une position plus défensive qu'offensive.
Alors dans ce contexte, l'UGTT serait-elle en mesure de gérer l'énorme masse potentielle de chômeurs, générée par
la déstructuration de pans entiers du tissu industriel local, non seulement dans le textile mais aussi dans la
plupart des autres activités économiques ? Je ne le pense pas. D'abord, parce qu'au-delà d'un certain seuil (et là
c'est une loi historique), le chômage devient ingérable. Ensuite, parce que les travailleurs dans le secteur privé
(en partie futurs chômeurs) sont syndicalement peu ou pas encadrés. Enfin, parce que le pays est totalement
dépourvu d'institutions d'« assurance chômage ».
Il y a quelques années, on s'est longtemps masturbé l'esprit au sein de l'UGTT pour concevoir à temps une
« caisse-chômage » (études, séminaires, débats houleux...). Mais, jusqu'à présent, rien ne s'est concrétisé dans ce
sens. C'est là un exemple typique du discours creux qui persiste au sein de l'UGTT. Par ailleurs, en 1997, l'État a
instauré au sein de la Caisse Nationale de Sécurité Sociale (CNSS) un régime dit de « protection sociale des
travailleurs » destiné, du moins en apparence, à soutenir pendant quelques mois les salariés licenciés pour des
raisons économiques ou technologiques. Depuis, ce régime s'est avéré une simple courroie de collecte de ressources
fraîches pour la CNSS, déjà en difficulté du point de vue financier. En 2002, ce régime a eu pour ressources 20.2
millions de dinars et pour dépenses 1.4 millions de dinars (c'est ridicule non ?). Face à ce genre d'aberrations,
l'UGTT, pourtant membre à part entière du conseil d'administration de la CNSS, donne l'impression d'être
insensible, voire inexistante.
Livré ainsi à lui-même, le chômage devient porteur d'une double menace : la misère et l'insécurité. Car tout
problème qui n'est pas débattu et résolu dans le cadre des institutions finit tôt ou tard par exploser dans la rue.
Les dégâts qui pourraient en résulter sont inestimables.
Le taux de chômage de 15% environ va-t-il bondir ? Permettez-moi d'abord d'ouvrir une parenthèse concernant la
fiabilité de ce genre de taux. La proportion du chômage dans la population active ne peut, en principe, être
sérieusement et honnêtement appréhendée qu'à travers les « enquêtes ou recensements de la population ». Or, depuis
une quarantaine d'années, on n'a cessé de jouer sur les mots pour minimiser artificiellement le chômage. Par
exemple, le recensement de 1966 considérait comme chômeur « l'actif qui a travaillé 9 jours ou moins pendant le
mois précédant le jour du recensement ». Par contre, le recensement de 2004 ne considérait comme chômeur que
« l'actif n'ayant pas travaillé au moins une heure, avec ou sans rémunération, pendant la semaine précédant le jour
du recensement ». Il est évident que cette gymnastique des définitions rend toute comparaison inter-temporelle du
taux de chômage fallacieuse. Il est vrai que ce genre de tromperies est véhiculé par un organisme mondial : le BIT.
Comme la Banque Mondiale ou le FMI, cet organisme tente de faire intérioriser aux travailleurs leur misère à
travers la manipulation des chiffres. Mais il est vrai aussi, qu'à travers ce jeu de mots, nos dirigeants croient
pouvoir déguiser ces drames menaçants. Pourtant, ce genre de drames sont quotidiennement vécus par la majorité des
ménages. C'est donc une chimère que d'essayer de cacher le soleil avec un tamis.
Alors, de combien serait le chômage dans les dix ou quinze années à venir ? Statistiquement parlant, personne ne
peut l'estimer de façon plus ou moins exacte. Cette chakchouka des données statistiques officielles
empêche de le faire même si on est un excellent prévisionniste. Mais certainement, ce phénomène aurait tendance à
s'amplifier de façon intenable, suite à plusieurs facteurs conjugués : totale ouverture de l'économie sur
l'extérieur ; fléchissement de l'investissement privé local ; piétinement, voire fuite, des investissements directs
étrangers ; mutations technologiques substituant inlassablement la machine à l'homme ; quasi rupture entre le
système éducatif et le marché de l'emploi, etc.
Signalons que la récession en perspective du textile en Tunisie n'est pas due seulement au démantèlement des
accords multifibres, mais aussi à d'autres facteurs non moins importants, tels que la montée fulgurante de la Chine
et son adhésion à l'OMC ; l'extension de l'Union Européenne à une dizaine d'autres pays qui en sont devenus membres
à part entière ; la faible attractivité pour de vrais investissements étrangers ; l'effritement du tissu
productif local (perte des économies d'échelle) ; et surtout la spécialisation de notre pays dans des produits peu
compétitifs. Vu sa proximité avec l'Europe, la Tunisie n'avait de chance de préserver une partie de ce marché qu'en
se spécialisant dans l'habillement personnalisé en petites séries de moyenne et haute gamme, et non dans
l'habillement standardisé en grandes séries de bas de gamme. Personnellement, depuis une quinzaine d'années, j'ai
attiré à maintes reprises l'attention sur la nécessité de cette reconversion, mais en vain. Pourtant, avec beaucoup
de retard (en 2004), le patron de l'UTICA, Hédi Jilani, déclarait : « Il ya des produits standards qui sont
désormais l'apanage des pays asiatiques et pour lesquels nous ne pouvons plus faire prévaloir notre avantage
comparatif. Il y a en revanche des produits qui sont sensibles à la mode et pour lesquels il faut être apte à
s'adapter aux changements rapides » (L'économiste maghrébin n°362 du 24 mars 2004). Cette attitude reflète
une constante chez la majorité des tunisiens : on ne prévoit jamais à temps la catastrophe ; on n'en devient
conscient que lorsqu'elle tombe sur notre tête.
A.C. : Ce chômage (dans le textile) va-t-il concerner essentiellement une population ouvrière féminine ? Et dans
cette logique, compte tenu d'une perception plutôt masculine qui déprécie « ces femmes qui prennent le travail des
hommes », peut-on attendre de l'UGTT qu'elle défende véritablement les intérêts de ces ouvrières, qu'elle les
considère comme des « exclues de leur emploi » et non comme des femmes retournées à leurs fourneaux ?
H.D. : Oui, le chômage dans le textile pourrait toucher surtout les femmes. Car, actuellement, environ 3/4
des actifs dans cette activité (en particulier la confection) sont constitués de femmes, suant du matin au soir à
la taylorienne, et mangeant à midi des casse-croûtes à notre appétissante Harissa ou des yaourts sans
goût. D'ailleurs, leurs conditions mérite un roman à la Zola.
D'après mes propres pressentiments, la ségrégation homme-femme ne constitue pas un phénomène choquant au sein de
l'UGTT. En tout cas, épouser des slogans tels que « ces femmes qui prennent le travail des hommes », c'est naviguer
à contre-courant de l'histoire, non pour des raisons idéologiques ou civilisationnelles, mais pour des raisons de
subsistance vitale. Vu la pression croissante des besoins sur les ménages, d'une part, et les pesantes contraintes
d'insertion dans la vie professionnelle, d'autre part, la majorité des hommes ne voient plus dans la femme
travailleuse contre salaire une concurrente mais plutôt une nécessité, voire un appui. D'ailleurs, pour se marier,
les hommes cherchent de plus en plus des femmes qui travaillent contre rémunération, car un seul revenu ne peut
plus faire vivre un ménage.
Donc la vraie question qui se pose aujourd'hui ne relève pas de la capacité de l'UGTT à défendre ces femmes
« exclues de leur emploi » mais de sa capacité à défendre tous les licenciés, quel que soit leur genre.
A.C. : Les nouveaux demandeurs d'emploi arrivent par dizaines de milliers chaque année sur le marché du travail.
À combien se chiffre cette demande additionnelle ? Faut-il se plaindre d'une politique hyperactive de formation
professionnelle qui serait disproportionnée en regard de la capacité d'absorption du tissu économique ?
H.D. : D'ici à 2010, la demande additionnelle d'emplois serait de l'ordre de 80 000 par an. À partir de
2011, cette demande accusera une tendance à la baisse, conséquence de la chute de la fécondité entamée dans notre
pays depuis le milieu des années 80. Remarquons que quel que soit son niveau durant les prochaines décennies, cette
demande additionnelle d'emplois n'est pas très inquiétante en soi. Ce qui est vraiment inquiétant, c'est la
capacité du pays à générer des nouveaux emplois. Durant les périodes de quasi prospérité de l'économie, celle-ci
n'a pu générer plus d'une cinquantaine de milliers d'emplois plus ou moins stables et rémunérateurs. Alors que dire
des années de récession en perspective.
Quant à la formation professionnelle, elle ne serait pas disproportionnée en regard de la capacité d'absorption du
tissu économique. C'est même le contraire qui se passe actuellement dans le pays. Des signes montrent qu'autant la
vraie formation professionnelle s'apprécie, autant les diplômes de l'enseignement secondaire et supérieur se
déprécient. L'accès aux instituts de formation professionnelle se fait désormais sur concours, et le nombre de
candidats dépasse toujours de très loin le nombre de places disponibles dans ces instituts. Mais ce qui est
vraiment étonnant, c'est qu'un grand nombre parmi ces candidats sont déjà détenteurs de maîtrises de l'enseignement
supérieur. L'une des ironies de notre époque, c'est qu'après avoir trimbalé ses savates dans les facultés-casernes
pour décrocher une pseudo-maîtrise, l'étudiant diplômé se sent de nouveau contraint de subir des études de
formation professionnelle, à un âge peu propice à l'acquisition d'un métier (26-27 ans en moyenne).
A.C. : Cependant, le ministère de l'enseignement supérieur se glorifie du taux des inscrits en fac dans la
tranche d'âge des 19-24 ans (42%, le taux varie suivant les interventions du ministre !) presque comparable au
taux de l'OCDE. Que pensez-vous de cette massification de l'enseignement supérieur, de la décentralisation
précipitée de la carte universitaire, de la multiplication des filières-gadgets ?
H.D. : La massification à outrance et sans discernement de l'enseignement supérieur est l'un des plus grands
drames que vit - et vivra encore pour longtemps - notre pays. Du point de vue quantitatif, l'enseignement supérieur
génère actuellement plus de 40 000 diplômés par an, et on s'attend à environ 100 000 diplômés vers 2020.
Or, durant le dernier quart de siècle, le pays n'a pu créer plus de 10 000 vrais emplois par an pour les
diplômés du supérieur. Ces quelques chiffres sont déjà suffisants pour montrer la gravité du défi qu'affrontera le
pays dans les années à venir. Faut-il rappeler que durant le dernier quart de siècle, c'est le secteur public
(administration, enseignement, santé, entreprises publiques) qui a absorbé l'essentiel des sortants de
l'enseignement supérieur. Or, avec le désistement de l'État de son rôle régulateur, la saturation des besoins en
enseignants (surtout dans le secondaire à partir de 2008), et la privatisation tous azimuts des entreprises
publiques, les opportunités d'emplois pour les diplômés du supérieur seront nécessairement plus limitées
qu'auparavant. Dans ce domaine, les entreprises privées, peu priseuses de diplômés du supérieur, ne seront en
aucune manière en mesure de prendre la relève du secteur public.
Du point de vue qualitatif, l'insertion de cette masse croissante des diplômés du supérieur dans la vie
professionnelle devient encore plus problématique. La majorité de ces diplômés (80% environ) quittent
l'enseignement avec des maîtrises, c'est-à-dire avec des bribes de savoir trop abstraites et peu assimilées.
Autrement dit, la plupart de ces sortants du supérieur, démunis de tout « savoir-faire » et surtout de tout
« pouvoir faire », ne servent dans le meilleur des cas que dans l'enseignement, domaine en voie de saturation.
La décentralisation précipitée de la carte universitaire ainsi que la multiplication des filières-gadgets n'ont
fait en réalité qu'accentuer la dégradation qualitative des diplômés de l'enseignement supérieur.
Notons que face à ce drame, les pouvoirs publics tentent depuis quelques années de le traiter à son amont plutôt
qu'à son aval. En effet, tout en continuant à massifier de façon improvisée l'enseignement supérieur, sécrétant des
diplômés de très mauvaise qualité, ces pouvoirs publics n'ont cessé de concocter des « fonds et programmes
d'insertion » qui n'offrent à ces diplômés que des emplois précaires et éphémères. Sur ce plan, la Tunisie est en
train de rater une chance historique. Car si les pouvoirs publics avaient centré leurs efforts sur l'amélioration
de la qualité de l'enseignement supérieur (l'amont du mal), ses diplômés auraient pu être facilement placés dans
les pays souffrant d'un vieillissement de leur population, et en particulier l'Europe.
A.C. : Votre collègue, l'universitaire M. Zouari en charge l'an dernier d'un rapport d'évaluation de
l'enseignement supérieur, mettait en cause publiquement une formation supérieure scholastique, récitative, nourrie
d'automatismes plus que de réflexion et d'analyse, peu adaptée aux exigences du monde moderne, ce que j'ai appelé
« la pédagogie du kottab ». Depuis M. Zouari s'est dessaisi de cette tâche. Êtes-vous du même avis ?
H.D. : Oui, je suis absolument du même avis que mon collègue et ami Zouari quant à cette évaluation de
l'enseignement supérieur. D'ailleurs, c'est justement ces tares qui expliquent en très grande partie la dégradation
qualitative des diplômés de l'enseignement supérieur. J'ajoute que toutes les soi-disant réformes, ayant touché
l'enseignement supérieur durant les années 90, n'ont fait qu'accentuer ces tares. En effet, ces réformes ont
parfaitement réussi à adapter l'enseignement supérieur à la médiocrité de l'enseignement secondaire.
A.C. : Pensez-vous que la professionnalisation de l'enseignement supérieur par la multiplication des filières
courtes soit une bonne chose dans le cadre d'une économie mondialisée qui décentralise les tâches secondaires ou
parcellaires dans les pays émergents comme la Tunisie ?
H.D. : Faisons d'abord la part des choses. La multiplication des filières courtes au sein de notre
enseignement supérieur ne signifie pas nécessairement sa professionnalisation. À mon avis, cette démarche, telle
qu'elle est entreprise, vise tout simplement à raccourcir la période d'acquisition des médiocrités, par comparaison
avec les filières moyennes et longues. En fait, cette multiplication des filières courtes répond à un souci
d'économie de moyens financiers. La massification de l'enseignement supérieur étant devenue terriblement coûteuse
pour la collectivité.
A.C. : À supposer que le niveau et le destin de notre société fassent qu'elle devienne une société de petites
mains et de sous-traitance, les restrictions apportées en Europe aux délocalisations (surtout en France, par
exemple celles qui commencent avec les centres d'appel) ne réduisent-elles pas encore ces perspectives ?
H.D. : En réalité, l'Europe continue à délocaliser, non à la recherche d'une main d'oeuvre bon marché
(vision surannée) mais à la recherche d'espaces de consommation potentiels significatifs, tels l'Asie du Sud (en
particulier la Chine), l'Europe de l'Est (en particulier la Pologne, la Hongrie et la Tchéquie), et l'Amérique
Latine (en particulier le Brésil et l'Argentine). Par rapport à ces géants, l'espace de consommation tunisien,
voire maghrébin, demeure insignifiant, et donc peu attractif pour les investissements européens.
A.C. : Le tourisme, malgré les aléas de la conjoncture internationale, continue - disent les autorités - à être
pourvoyeur d'emplois et de richesses. Mais alors, pourquoi l'enseignement supérieur et la formation professionnelle
ne vont-ils pas davantage dans le sens des métiers de l'hôtellerie et annexes, pour avoir un tourisme plus créatif
et plus haut de gamme ?
H.D. : Certes, le tourisme est pourvoyeur d'un certain nombre d'emplois, en majorité instables et précaires.
Mais en tout cas, il n'est nullement pourvoyeur de richesses. Au contraire même, depuis très longtemps, le tourisme
est devenu une source d'appauvrissement du pays.
Par exemple, un touriste allemand (l'un des principaux clients de la Tunisie) rapportait en moyenne 745 dinars
courants en 2002 contre 350 dinars courants en 1986, soit une apparente progression de 113%. Mais c'est là le cas
typique des chiffres trompeurs. Car dans ces calculs, on ne prend en considération ni l'énorme dépréciation du
dinar par rapport au deutschmark allemand ni la hausse des prix des produits consommés par les touristes. Reprenons
alors les calculs. En dinars à parité constante de 1990 par rapport au deutschmark, un touriste allemand rapportait
587 dinars en 2002 contre 518 en 1986, soit une progression de 13% seulement. Mais en dinars à parité constante de
1990 par rapport au deutschmark et aux prix à la consommation constants de 1990, un touriste allemand rapportait
361 dinars en 2002 contre 690 en 1986, soit une régression de 48%. Les calculs en dinars courants nous donnent donc
l'illusion de nous enrichir, alors que les calculs en dinars constants (c'est-à-dire réels) prouvent que nous
sommes en train de nous appauvrir, voire de nous ruiner.
Ces données montrent aussi que le tourisme tunisien souffre depuis longtemps d'une crise structurelle. Les aléas de
conjoncture internes et/ou externes (évènements du 11 septembre 2001 aux États-Unis, évènements de Djerba, seconde
guerre du Golfe,...) ne font en réalité qu'aggraver cette crise.
Cette crise structurelle du tourisme tunisien trouve ses origines dans deux causes essentielles. La première de ces
causes relève d'un comportement étrange des hôteliers tunisiens qui privilégient la « pierre » (construction de
somptueuses unités hôtelières souvent à crédit) aux dépens de la qualité du service touristique (accueil,
restauration, animation, entretien, hygiène et propreté, embellissement du milieu,...). À tel point que certains
n'ont pas hésité à dénommer ces hôteliers des « marbriers ». Dans ces conditions, en cas de chute des arrivées
touristiques, ces hôteliers tentent de se rattraper non en améliorant la qualité de leur produit mais en cassant le
prix des nuitées. De son côté, l'État les appuie en dévaluant par cascades la monnaie nationale. En agissant de
cette façon, nos hôteliers provoquent un processus régressif infernal : la chute des arrivées les pousse à casser
les prix, d'où détérioration encore plus manifeste de la qualité du produit, entraînant une rechute des arrivées,
et ainsi de suite jusqu'à l'écroulement final.
La crise structurelle du tourisme tunisien trouve aussi ses origines dans un autre comportement bizarroïde des
hôteliers. Alors que la clientèle tunisienne est formée depuis très longtemps essentiellement d'un « tourisme de
groupe », destiné aux catégories pauvres et moyennes européennes, et fréquentant normalement les hôtels deux et
trois étoiles, les hôteliers tunisiens s'orientent de plus en plus vers l'édification d'hôtels quatre et cinq
étoiles. Autrement dit, ces hôteliers ne cessent de construire à crédit le luxe pour le vendre au rabais. Gérard
Pélisson, l'un des plus grands professionnels touristiques du monde, a parfaitement résumé ce flagrant paradoxe du
tourisme tunisien : « la façon la plus sûr de faire faillite en hôtellerie, c'est de faire un hôtel 4 étoiles, de
le gérer comme un 3 étoiles et de faire payer aux clients des prix d'un 2 étoiles. C'est la recette d'un échec
garanti. » (L'économiste maghrébin n°302 du 2 décembre 2001) [NDLR : selon une dépêche AP du
18 octobre 2004, le groupe français d'hôtellerie Accor, présidé par Gérard Pélisson, annonce un plan
d'investissement de près de 70 millions d'euros pour 2005 en Tunisie. Outre le lancement d'unités hôtelières, le
plan comporte surtout un volet professionnalisant, avec « une académie destinée à la formation de cadres pour
améliorer la qualité des services offerts à la clientèle Accor », selon AP. Actuellement en visite
en Tunisie pour la promotion de cet investissement, Gérard Pélisson confirme à
l'agence que le plus important est d'améliorer la qualité du service : « la formation est la clé de la
réussite dans notre profession », a-t-il ainsi déclaré. Cette académie sera-t-elle
pour autant réservée aux employés du groupe Accor, ou profitera-t-elle au contraire à l'hôtellerie
tunisienne dans son ensemble ?].
Signalons que l'insuffisante qualification du personnel hôtelier constitue l'une des raisons de la médiocrité du
service touristique tunisien. Aussi bien l'État que les hôteliers ont toujours rechigné à investir dans la
formation du personnel touristique. L'Institut de Sidi Dhrif est demeuré pendant des décennies l'unique institution
de formation supérieure, spécialisée dans le tourisme. Et sa capacité de formation est restée insignifiante par
rapport aux masses d'étudiants entassés dans les facultés-casernes. Par ailleurs, durant la décennie 1993-2003, les
emplois directs créés par le tourisme sont estimés à 34 600, alors que durant la même période, toutes les
institutions de formation touristique du pays n'ont sécrété que 9 700 diplômés plus ou moins qualifiés
(essentiellement avec des brevets de techniciens professionnels et des brevets de techniciens supérieurs), soit 28%
seulement des besoins. Le reste des travailleurs ont été soit formés sur le tas, soit recrutés dans la rue pour des
durées déterminées et avec des salaires minables. Voilà encore un paradoxe : dans un pays où l'on considère le
tourisme comme l'un des piliers de l'économie, la formation de qualité pour ce secteur y est demeurée marginale et
insignifiante.
A.C. : Votre réponse est édifiante. Nous reviendrons, à une autre occasion, sur l'emploi dans les services,
vaste question. Mais voici une petite interrogation annexe : le commerce parallèle est une soupape, un appel d'air.
Son contrôle ne va-t-il pas faire des chômeurs de plus (voire des délinquants car ce commerce parallèle est
alimenté par le trafic) ?
H.D. : Oui, le commerce parallèle, et en particulier le commerce ambulant et des frontières, a toujours
constitué un refuge pour les sous-employés, surtout en périodes de crise. Toutefois, ce genre de commerce génère
souvent des tensions entre certaines fractions sociales. Car ce commerce milite en faveur des trafiquants, des
sous-employés, et parfois des consommateurs, mais il altère les intérêts de l'État (manque à gagner fiscal
consistant) ainsi que les intérêts des commerçants stables et patentés. Dilemme encore. Car neutraliser ce commerce
parallèle risque de déstabiliser gravement certaines fractions sociales, voire certaines régions (en particulier
les gouvernorats frontaliers). A contrario, laisser ce genre de commerce s'amplifier risque de détruire carrément
le commerce régulier.
Cette « Issaouia » rappelle l'ambiance qui régnait à la fin de l'époque coloniale et au début de l'indépendance
mais à une différence près : l'orchestre est devenu mené par une poignée de trafiquants attitrés. Afin d'atténuer
cette anarchie du commerce, l'État aurait dû « discipliner » cette poignée aux frontières, au lieu de faire
l'inutile et dangereuse chasse à ces piteux milliers de marchands ambulants dans les souks et les rues.
A.C. : L'agriculture mérite tout un dossier. Mais, dans une vision globale, en l'état de la menace qui pèse sur
nos exportations du fait de la surproduction européenne et des nouveaux exportateurs de l'Europe de l'est, notre
agriculture retient-elle les bras ou les rejette-t-elle ? Peut-elle être, elle aussi, porteuse de mouvements
sociaux ?
H.D. : Oui l'agriculture mérite tout un dossier. De même il n'est pas possible de déceler le devenir de
cette agriculture sans un recul historique suffisant.
Depuis des millénaires, l'agriculture tunisienne souffrait de conditions climatiques trop ingrates (fortes
irrégularités pluviométriques inter annuelles et inter saisonnières, rareté des sols à fertilité
satisfaisante,...). De son côté, l'homme n'a cessé d'aggraver ces contraintes du milieu, surtout au cours du siècle
dernier (déforestation à outrance, rétrécissement des parcours naturels, diffusion anarchique de la mécanisation,
surexploitation des sols et des nappes phréatiques, extension sans merci de l'habitat anarchique,...). Tous ces
phénomènes ont largement contribué à la dégradation du patrimoine agricole, sous les effets de l'érosion, de la
désertification, de la salinisation, et de pla ollution des sols utiles. Parallèlement, les exploitations
agricoles n'ont cessé de se disloquer (morcellement et parcellisation à outrance), suite à l'héritage, à la
privatisation des terres domaniales et à la dissolution des terres collectives (arch) et des terres
habous. Aujourd'hui, environ 90% des exploitations agricoles du pays a une superficie égale ou inférieure
à 20 hectares. Or, une exploitation de 20 ha, cultivée en blé dans une région à climat semi-aride, procure un
revenu net tout juste égal au SMIG. Alors que dire des très nombreuses exploitations à un ou deux hectares...
Dans ces conditions, jusqu'à la colonisation, et plus précisément jusqu'à la seconde guerre mondiale, nos ancêtres
n'ont cessé de gratter le sol pour assurer leur subsistance, sans pouvoir toujours échapper aux famines. Dans le
cadre de cette agriculture d'autoconsommation, nos ancêtres étaient donc trop soumis aux contraintes de la nature
mais très peu aux contraintes du marché. Cela veut dire que nos ancêtres n'avaient ni des soucis de coût de
production ni des soucis de prix de vente.
Or, depuis la seconde guerre mondiale, l'agriculture tunisienne n'a cessé de se marchandiser. On ne produit plus
seulement pour manger, mais aussi et surtout pour vendre. Du coup, la paysannerie est devenue soumise à une double
série de contraintes angoissantes : celles de la nature et celles du marché. Dans ces conditions, l'agriculture
tunisienne ne pourrait plus survivre sans le soutien et la protection de l'État.
Du début de l'indépendance et jusqu'au milieu des années 80, l'État tunisien n'a cessé de soutenir l'agriculture au
niveau de sa sphère de production, à travers différents mécanismes : exonérations fiscales, bonification des taux
d'intérêt agricoles, et surtout subvention de tous les intrants agricoles (infrastructure hydraulique,
mécanisation, semences, engrais chimiques, insecticides et pesticides, eau, aliments du cheptel, etc.). De même,
durant cette période, l'État n'a cessé de protéger l'agriculture, en instaurant d'étanches barrières douanières
face aux importations alimentaires, et ce aussi bien en matière tarifaire qu'en matière de quotas.
À partir du milieu des années 80, la protection et le soutien étatiques de l'agriculture ont persisté, bien qu'ils
aient changé de forme. Certes, l'État s'est progressivement désisté du soutien de l'agriculture au niveau de sa
sphère de production (disparition progressive des subventions de la plupart des intrants agricoles). Mais ce
soutien étatique de l'agriculture s'est simplement déplacé au niveau de sa sphère de circulation. En effet, les
prix à la production des principaux produits agricoles (et en particulier les céréales et le lait) sont désormais
fixés par l'État à un niveau largement supérieur aux prix des produits similaires importés. Par exemple, au cours
de la dernière décennie, le prix à la production du blé local fixé par l'État dépassait en moyenne de 60% le prix
du blé importé.
Ce survol historique de l'agriculture tunisienne montre que celle-ci n'a pu - et ne pourrait - survivre hors
perfusion et protection de l'État. Alors, deux questions fondamentales se posent quant au destin futur de cette
agriculture. D'abord, dans les décennies à venir, l'État sera-t-il en mesure de continuer à soutenir l'agriculture,
alors qu'il est lui-même soumis à des pressions budgétaires de plus en plus contraignantes. Au cas où l'État se
désisterait totalement du soutien de l'agriculture, celle-ci serait sûrement vouée à une mort à feu doux. Ensuite,
l'État sera-t-il en mesure de continuer à protéger l'agriculture, alors qu'il est soumis à des pressions
lancinantes, surtout de la part de l'Union Européenne, exigeant une plus large ouverture du marché local pour ses
produits alimentaires. Au cas où l'État se désisterait totalement du soutien de l'agriculture, et où il ouvrirait
largement le marché local pour les produits alimentaires de l'Union Européenne (qui nous dépasse de très loin en
termes de rendements, donc de coûts et de prix), cette agriculture serait certainement vouée à une mort à feu
cuisant. L'une des terribles conséquences de cette dernière éventualité serait un dépeuplement des campagnes et une
reprise sans précédent de l'exode rural et de l'anarchie totale dans les villes.
A.C. : Dans un survol de notre économie, voyez-vous pour les cinq ans à venir plus de taches sombres que de
perspectives heureuses ?
H.D. : Malheureusement oui. Et je pense que ça ne fait plaisir à personne, mais les faits sont là.
L'histoire d'une nation se crée, mais se subit aussi. Et lorsque, pour une raison ou une autre, on se sent
marginalisé en tant qu'acteur de cette histoire, on ressent doublement la mort dans l'âme.